|
HISTOIRE
DE LA VILLE DE RIVE DE GIER -DU CANTON ET DE SES PRINCIPALES INDUSTRIES
par C. CHOMIENNE - 1912
|
|
APOGE ET DECLIN
DU CANAL DE GIVORS
|
|
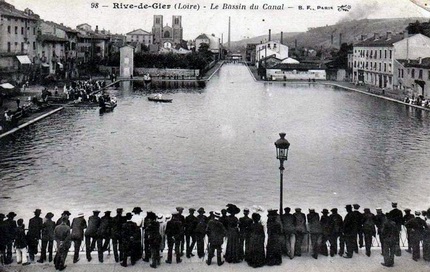
|
L'utilité du canal, en
1789, se, trouvait dans les facilités offertes à l'exportation des
charbons des mines de Rive-de-Gier à Lyon et, sur les rives de la Saône
et du Rhône jusqu'à la Méditerranée, et au transport des fers qui se
travaillaient à Saint-Etienne et à Saint-Chamond
C'est en 1792 que fut
commencée la construction de l'Hôtel du canal. Les travaux en furent
interrompus par la tourmente révolutionnaire de 1793, qui dispersa les
administrateurs et fit placer le canal sous séquestre. La construction
fut reprise en 1794 et terminée en 1796.
La ruine des transports
par terre (Le transport de la houille se faisait à dos de mulets avant
1780) opérée par la concurrence du canal, fournil aux concessionnaires
des mines l'occasion de faire des traités plus avantageux avec les
acheteurs, des traités plus avantageux avec les acheteurs, et, dès ce
moment, leurs concessions, auparavant peu lucratives, rapportèrent
davantage.
|
|
Rive de Gier - Le Bassin
du Canal |
| La navigation ne laissa
pas de prendre quelque accroissement en 1781, moyennant des primes que
la Compagnie accorda aux marchands de houille. Ces primes consistaient
dans la remise d'un sol par mesure, lorsque dans le cours de l'année
ils en avaient exporté par le canal de 80.000 à 100.000 mesures. Le
tonnage, qui n'était que de 3.500 tonnes pour les deux années 1780 et
1781, s'élevait déjà à 14.500 tonnes en 1789. En 1807, il était de
26.000 tonnes et en 1820, de 242.000 tonnes.
Pour la période des dix
premières années (1780-1789), les recettes ont été de 2.992.700
francs ; les bénéfices de 163.000 francs. Pour l'année 1821 seule,
les recettes se sont élevées 816.440 francs et 555.500 francs ont été
distribués aux actionnaires. Les actions émises à 15.000 francs et
portées ensuite à 16.000 francs valaient alors 200.000 francs et
rapportaient 7 %. C'est à cette époque que la Compagnie, enivrée de
son succès, usant du droit que lui avaient conféré les
lettres-patentes de 1779, doubla les prix de ses transports. Le tonnage
pourtant ne cessa pas de s'accroître ; il atteignit, en 1827, l'année
la plus prospère, 332.000 tonnes. Les recettes, cette année-là, s'élevèrent
à 1.322.500 francs et 1.144.000 francs furent distribués aux
actionnaires. On était, alors au point culminant de la prospérité de
Rive-de-Gier. |
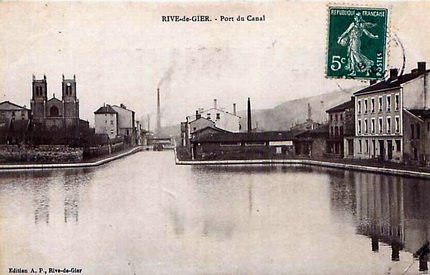
|
|
Rive de Gier - Le Canal
Quartier Berthelas |
|

|
Le 3 décembre 1831
intervint une Ordonnance Royale de concession perpétuelle pour le
prolongement du canal jusqu'à Grand’Croix. Ce prolongement fut immédiatement
entrepris et terminé en 1839. Les dépenses totales pour la
construction du canal de Givors à Grand'Croix et de ses dépendances
ont atteint la somme ronde de dix millions.
On se trouvait alors en
pleine extension de Rive-de-Gier. L'extraction de la houille était à
son apogée et, facilitées par l'abondance et le bas prix du
combustible, diverses industries se développaient rapidement. Les
verreries Richarme, Roichot, Lanoir et la Compagnie générale de la
Loire et du Rhône contribuèrent à augmenter le nombre d'habitants
dans une proportion notable. Un peu plus tard que les verreries, des
forges s'installèrent dans la partie Sud-ouest de la ville. Très
modestes à leur début, elles ne tardèrent pas à leur tour à prendre
un grand développement, et le chiffre de la population crût d'une façon
notable. Mais le tonnage du canal qui, jusqu'en 1827, avait suivi une
marche régulièrement ascendante, commençait
à baisser ; de 246.000 tonnes en 1830, il tomba à 172.000 tonnes en
184o, pour remonter à 238.000 tonnes en 1850 ; mais à partir de cette
dernière époque, la décadence s'accentua : 146.000 tonnes en 1860 ;
82.000 tonnes en 1870, et finalement 24.000 tonnes en 1878.
|
|
Rive de Gier - Le Canal et
Le Gier |
|
Depuis lors, le canal
est resté inactif ou à peu près. C'est que le chemin de fer construit
sur la rive droite du Gier, en 1832, avait créé une concurrence sérieuse
aux transports par eau. D'un autre côté, le prolongement jusqu'à
Grand'Croix n'avait pas donné de bons résultats. La partie haute ne
put être mise en exploitation, parce que les biefs perdaient leur eau
par les fissures du sol provenant de l'exploitation des mines.
En I84I, le pont-canal
qui traversait le Gier, à Lorette, fut emporté par une crue de la rivière.
La cuvette, remplacée par une bâche en bois, fut de nouveau emportée
en 1851 ; on dut abandonner la section de Grand'Croix à Lorette.
En 1872, le petit
barrage et l'aqueduc de Varrey, qui amenaient au canal, à la hauteur du
Sardon, les eaux du réservoir de Couzon, furent à leurs tours enlevés
par une crue et la section de Lorette à la 32ème écluse dut être
abandonnée. Les transports furent ainsi réduits de Givors à l'extrémité
Ouest de la ville de Rive-de-Gier.
|
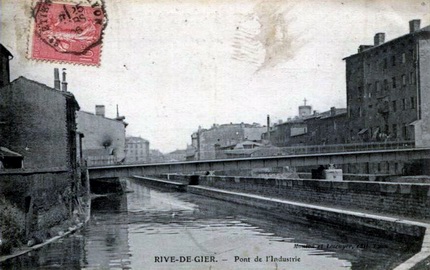
|
|
Rive de Gier - Pont de
l'Industrie |
|
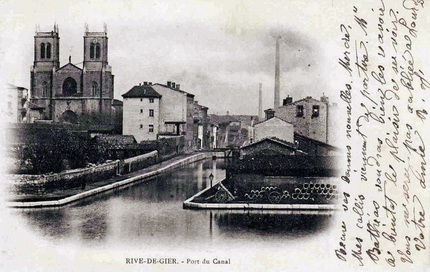
|
Mais la cause principale
de la ruine du Canal de Givors fut à coup sûr la concurrence du chemin
de fer, concurrence à laquelle cette Compagnie ne sut pas résister.
Elle abaissa bien les prix de son tarif pour les mettre en rapport avec
ceux du chemin de fer ; mais, au lieu de continuer la lutte, elle prit
peur et passa, en 1841, avec la Compagnie du chemin de fer, un traité
mettant en commun les produits des deux exploitations, traité pour
lequel le chemin de fer se fit naturellement la part du lion (70 % au
chemin de fer et 30 % au canal).
D'un autre côté, en
185o, la Compagnie des mines de la Loire s'engagea, moyennant une réduction
de tarif, à donner tous ses transports au chemin de fer. Enfin, en
1862, la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon réunit à son réseau
le chemin de fer de la rive droite du Gier, le répara et, peu après,
par le pont de Chasse, le mit en communication avec la ligne principale.
Dès lors, il n'y avait plus de lutte possible ; les facilités de
transport par le chemin de fer étaient trop grandes et n'auraient pu être
compensées que par un abaissement considérable du tarif, abaissement
que les circonstances ne permettaient plus. En effet, la Compagnie des
mines réunies avait signé, en 1845, avec le syndicat de la Société
formée pour l'exploitation du canal de Givors, un traité par lequel
elle prenait à bail, pour une durée de 82 ans, le canal de Givors et
toutes ses dépendances, mobilier et matériel compris, moyennant un
prix annuel, progressif jusqu'à la dixième année, où il devait
atteindre le chiffre maximum de 240.000 francs, somme à payer toutes
les années suivantes. Cette redevance était trop élevée et ne
permettait pas un abaissement de tarif suffisant pour lutter contre le
chemin de fer.
|
|
Rive de Gier - Port du
Canal |
|
En 1854, le Gouvernement,
ému par les plaintes du commerce et de l'industrie, au sujet de la réunion
d'un très grand nombre de concessions houillères en une seule
Compagnie et du renchérissement du charbon qui en était la conséquence,
le Gouvernement, disons-nous, armé de la loi de 1810, imposait le
partage des concessions entre quatre groupes distincts : la Compagnie de
Montrambert, la Compagnie de la Loire, la Compagnie de Saint-Etienne et
la Compagnie de Rive-de-Gier. L'exploitation du canal, avec ses bénéfices
et ses charges, fut, dans le partage, attribuée à la Compagnie de
Rive-de-Gier.
En 1857, la Compagnie P.
L. M. dénonça la résiliation du traité de 1841, qui la liait à la
Compagnie du Canal ; elle fut condamnée aux frais et à donner une
indemnité de 2.500.000 francs. C'était une belle aubaine pour la
Compagnie des Mines de Rive-de-Gier. Elle estima néanmoins qu'il serait
trop difficile et onéreux de soutenir la lutte de la navigation contre
la concurrence du chemin de fer et elle ne s'inquiéta même plus de
l'entretien du canal.
|
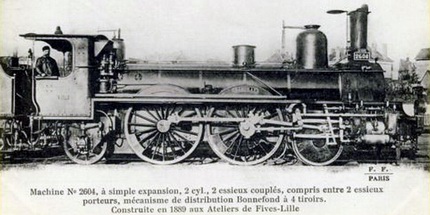
|
| Nous donnons pour mémoire
les derniers chiffres du tonnage décroissant du canal : |
|
En 1865 - 121.000 tonnes de houille |
|
En 1870 - 82.000 tonnes de houille |
|
En 1875 - 24.000 tonnes de houille |
|
On vit encore circuler des bateaux pendant quelques
années, les uns remontant des sables du Rhône pour les verreries, et les autres descendants des scories de forge pour les hauts fourneaux de
Givors.
Enfin, en 1878, la navigation fut complètement abandonnée.
Par une convention en date du 2 avril 1886, approuvée par la loi du 16 août
suivant, le Canal a été racheté par l'Etat qui en a pris possession le 4 novembre de la même
année.
L'Hôtel du Canal a été, par suite, cédé à la Ville, qui a, en
outre, été autorisée à prendre, dans le réservoir de Couzon et moyennant une
redevance, malheureusement trop élevée, l'eau nécessaire à sa
consommation.
Nous devons ajouter que l'abandon du Canal de Givors n'a eu, grâce à l'établissement du chemin de fer et à la diminution des
tarifs, aucune suite trop fâcheuse pour Rive-de-Gier, qui a continué à croître en population et en
prospérité. |
|
 Page Précédente Page Précédente
|

|
Haut de page
|
Page suivante
|
|
|