|
GIVORS PORT FLUVIAL
Auteur : Julien PAGE
Editeur André Martel 45, rue de Belfort, à Givors - 1950
Orné de 217 dessins de Claude Bordet
|
|
|
|
LE PORT.
Cette période fut assez riche en événements
inattendus. Les ports, et principalement le port de Givors, ont joué
un rôle important. C'était sur le Grand Port que fut installé le
corps de garde pendant « la Grande Peur ». C'était vers le Port
des Verreries que se rassemblèrent officiers et soldats de la Garde
nationale avant le défilé. C'était vers un bateau chargé que la
population s'était précipitée le 16 novembre. C'était de nos
ports que partaient Chomier, Mussieu, et plusieurs soldats pour répondre
à l'invitation faite par la Fédération de Beaucaire, au printemps
1790 ! Les bons rapports entre mariniers rhodaniens ont toujours
existé.
Aussi, la municipalité s'efforçait d'attirer
l'attention de l'Administration supérieure sur le Port de Givors
ravagé par les crues de 1789 et de 1790, en rédigeant un long mémoire,
en décembre 1790.
« La situation de ce bourg, sur le fleuve du
Rhône, a présenté de tous temps des avantages considérables à
la navigation, pour le commerce qui s'entretient entre les parties
du nord et du midi de la France.
|
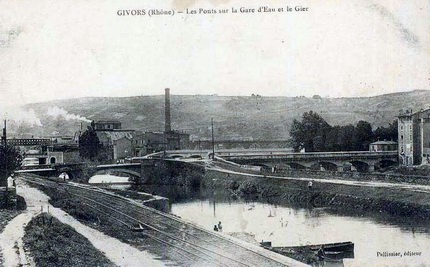
|
|
La Gare d'Eau
|
|

|
« C'est le lieu d'entrepôt des grains
descendant par le Rhône et la Saône pour l'approvisionnement des
provinces du Midi et de l'étranger ; c'est aussi le lieu
d'embarquement des merceries, « quincailleries », soieries et
autres objets provenant des manufactures des villes du Puy,
Saint-Etienne et Saint-Chamond, destinés pour le Levant, l'Amérique
et les colonies ; les charbons de terre provenant des carrières de
Rive-de-Gier y ont leur entrepôt et s'y embarquent pour les
provinces du Midi et l’Amérique.
« Les retours des navigateurs y rapportent le
fer, les épiceries et marchandises de toute nature pour
l’approvisionnement des villes du Forez, et de leur territoire,
telles que Montbrison, Feurs, Saint-Etienne, Saint-Chamond, et
autres moins considérables ; les vins du Languedoc et de la Côte
du Rhône pour l'approvisionnement de Paris et celui des autres
provinces du nord y ont aussi leur relâche, souvent même leur
entrepôt.
« La position de ce bourg est une des mieux
placées pour la relâche des bateaux, lors des gros temps. Situé
au pied d'une montagne qui en fait l'enceinte, ses ports sont abrités
des vents du Midi et de l'ouest qui sont les vents les plus à
redouter pour la navigation sur le Rhône.
|
|
Le Port sur le Rhône
|
|
« Tels sont, Messieurs, l'utilité et les
avantages qu'il présente. »
Après ce préambule, la municipalité
demandait des crédits pour effectuer les réparations
indispensables et suggérait que la vente des biens du Chapitre de
Lyon devait le permettre, car « les dégâts n'ont été si graves
que par la faute des seigneurs péagers qui en ont négligé
l'entretien. » Les sommes seront mandatées en l'an II de la République
française et les travaux immédiatement entrepris.
La suppression des privilèges permettait la réalisation
du bac à traille, le 25 août 1791. Peillon et Laurenson acceptèrent,
à leurs frais, risques et périls, de l'établir à la hauteur du
port du Bief, sans gêner la navigation, suivant les indications
données par Martinet Etienne, maire, et Pierre Collet, officier
municipal, tous deux maîtres patrons sur le fleuve. Un moulin à
eau près du bac et de la rive remplaçait le 12 octobre 1792, celui
qui avait été emporté par la débâcle des glaces le 30 décembre
1788.
|

|
|
Le Gier et la Gare d'Eau -
1909
|
|

|
LE MAINTIEN DE L'ORDRE
On supprima les corporations. Le droit de
coalition n'était pas reconnu par l'Assemblée Nationale
Constituante. La liberté commerciale triomphait. Néanmoins les 40
crocheteurs du port s'entendirent fort bien pour réclamer un sou
par quintal afin de charger la barquette de Pichat et Bonnardel
voituriers de Vienne à Givors. Mussieu, maire, arbitra le conflit
et accorda 9 deniers mais avec défense « de faire composer les
marchands et de ne susciter aucune émeute. » (68)
Le 25 mars 1790, éclatait un mouvement «
concerté depuis quelques jours et exécuté avec toute la fureur et
la violence possibles. » Pendant que la municipalité et le bureau
de la Fabrique, réunis dans l'église de Givors, étaient occupés
à entendre les comptes avant de procéder à la nomination d'un
nouveau luminier, plusieurs Givordins pénètrent en foule, en
criant « qu'ils ne voulaient plus de bancs et qu'ils entendaient,
de gré ou de force, les sortir. » En vain, on leur affirma que
l'on prendrait en considération leur demande, qu'il ne fallait
point user de violence, que l'église n'avait pas d'autres revenus.
Ils crièrent à tue-tête : « Point de bancs ! » et, entrant
comme des furieux dans l'église, ils se mettaient en devoir de les
arracher. Plus tard, les 36 bancs étaient brisés, jetés en
morceaux sur la place publique.
|
|
Une Borne présente au bord
du Canal
|
|
« La municipalité n'a pas seulement à se
plaindre de ce délit, mais aussi des dénommés J.-F. Bony et J.-C.
Charroin qui ont presque toujours été à la tête des émeutes
arrivées à Givors, et de celle d'aujourd'hui comme de celle du 15
novembre 1789 et de plusieurs autres dont aucun procès-verbal n'a
été dressé. Ils tiennent partout des propos séditieux et
incendiaires ».
Robichon et Peillon sont députés à Lyon pour
obtenir main forte.
|

|
|
Le canal
|
|

|
Un mois plus tard, les esprits n'étaient pas
encore calmés. Un attroupement fit plusieurs tours de la paroisse
avec armes, tambour et fifre, malgré les interdictions formulées
par le maire. Le 2 mai 1790, pendant que la municipalité était
assemblée, le défilé recommença : « Nous avons entendu battre
le tambour et ayant tous mis la tête aux fenêtres, nous avons vu
arriver, sur la place de Givors, une troupe de gens armés de 18 à
20 hommes, à la tête desquels était le nommé Chartre, ayant un
sabre nu à la main posé sur l’épaule droite, lequel donnait des
signaux à un tambour et à un fifre. Nous avons reconnu François
Berthier pour être le tambour et le nommé Savet, dit Besace, pour
être le fifre. Nous allions leur demander pourquoi et par quels
ordres, ils étaient ainsi armés. Mais ayant enfilé la rue de
Merdary, nous les avons perdus de vue. »
Seulement le lendemain, 3 mai, quelques
notables allaient acheter fusils, baïonnettes, sabres, gibecières,
à Saint-Etienne.
|
|
Le canal envahi par la
végétation
|
|
|
|