|
GIVORS PORT FLUVIAL
Auteur : Julien PAGE
Editeur André Martel 45, rue de Belfort, à Givors - 1950
Orné de 217 dessins de Claude Bordet
|
|
|
|
LA TROUPE A GIVORS.
En décembre 1788, le « Canal de Givors »
avait été érigé en fief à perpétuité aux actionnaires de
l'entreprise, Les « lettres patentes » ne furent enregistrées au
Parlement que le 5 septembre 1789 (69). C'est bien probablement le
dernier fief créé sous l'Ancien Régime ! Mais de ce fait la
Compagnie du Canal participa à toute l'impopularité qui atteignit
les institutions féodales. Les nouvelles autorités lui furent
hostiles. Elle eut tout le monde contre elle et notamment les
Givordins. En décembre 1789, ne fixèrent-ils pas à 1.200 livres
le montant des impositions de MM. les intéressés du Canal. Le
directeur Antoine Cailhava protestait dès janvier, consentant à ne
payer que les impositions qui existaient sur le sol occupé. Le conflit allait s'aggraver. Si l'Assemblée
Nationale Constituante avait proclamé l'abolition des privilèges
et l'égalité devant l'impôt, elle garantissait aussi la libre
concurrence et la libre circulation des produits. Mais l'ancienne
corporation des crocheteurs ou portefaix du Canal voulait conserver
ses prérogatives.
|

|
|
Double écluse - Tartaras
|
|

|
Le 7 octobre 1790, après-midi, Richard, son père
et son frère, étaient occupés à l'embouchure du canal et
faisaient monter plusieurs bateaux à Rive-de-Gier. Ils furent
assaillis par une foule de crocheteurs. Ils auraient été pendus à
la grue sans l'intervention de plusieurs personnes. Le lendemain,
ils connaissaient le même danger. Le maire averti fit retirer les
crocheteurs au nombre de 80 ; mais Richard avait jugé prudent de
passer de l'autre côté du Rhône à l'aide d'un petit bateau.
Le 12 octobre, la municipalité' de Lyon qui ne voulait pas que la
ville connaisse la disette de l'hiver 1788 signalait ces voies de
fait et demandait des mesures sérieuses. Le procureur de la commune
préparait une ordonnance en exécution des décrets de l'Assemblée
Nationale sanctionnés par le roi et notamment celui des Droits de
l'Homme et du Citoyen, où, en partant de cette loi, tous les hommes
avaient le droit de travailler et de gagner leur vie dans
toute l'étendue du royaume sans aucun obstacle.
«
Ce serait donc enfreindre cette sage loi, si Von souffrait que sur
le canal de Givors à Rive-de-Gier, il n'y eut qu'un certain nombre
de personnes qui s'emparassent de ce travail et en privassent les
autres. Ce serait admettre les privilèges. Vous savez qu'il n'en
existe plus. Et de là, il en résulterait encore d'autres inconvénients
qui deviendraient nuisibles au commerce parce qu'alors ce groupe de
préférés serait le maître de faire composer les marchands,
d'augmenter le prix des voitures, d'enchérir ce combustible si nécessaire
à la vie de l'homme et qui tomberait en pure perte aux
consommateurs.
|
|
Vestige d'une écluse au
bord de l'autoroute A47 - Givors Ouest
|
|
Cette bonne volonté ne parut pas suffisante au
Directoire du département qui, après intervention des
concessionnaires du Canal, envoyait une compagnie d'infanterie du régiment
de Guyenne, le lundi 18 octobre 1790, soit 3 officiers, 6
sous-officiers et 70 soldats, « pour y rester jusqu'à nouvel ordre.
»
Surprise générale. Eloge de la Garde
nationale : « Les quelques mouvements avaient été apaisés aussitôt
que commencés ». Protestation violente ! <(Les entrepreneurs du
Canal qui ont requis les troupes de ligne pour la sûreté de leur
canal — ce qui nous a été assuré par un officier de V
avant-garde de cette compagnie qui vient d'arriver — auraient pu
prévenir de leurs démarches la municipalité. Il est donc aisé de
s'apercevoir que les entrepreneurs du Canal, qui ont juré une haine
implacable contre la communauté de Givors, se rappellent toujours
de l'ancien régime et cherchent tous les moyens de l'asservir.
C'est une fatalité pour elle, mais le Directoire (du département)
ouvrira les yeux et verra que toutes leurs démarches ont toujours
été, jusqu'à présent, un tissu de fourberie.
|

|
|
Vestige du Canal le long de
l'autoroute A47 - Givors Ouest
|
|

|
« Ils voulurent être seigneurs. Ils se
persuadent encore pouvoir l'être, car ils refusent jusqu'au
paiement de l'impôt. L'entreprise rend quatre fois plus de revenus
aux entrepreneurs que toute l'étendue de cette commune, et par une
méchanceté des plus atroces, cette compagnie vient de requérir
des troupes de ligne à notre charge. Si elle en a besoin, qu'elle
les loge!.. »
La lutte va se poursuivre, ardente. A une
demande du capitaine pour grouper ses soldats dans < un seul bâtiment,
la municipalité signale que les « riches propriétaires du Canal
» en possèdent.
Mais au printemps suivant, 20 mars 1791, la
compagnie du Régiment de Guyenne était doublée. Ce n'est que sept
jours plus tard qu'on établira les billets de logement, à contrecœur,
et après de multiples protestations.
|
|
Vestige d'une écluse au
bord de l'autoroute A47
|
|
Pourtant quelques contestations éclataient à
propos de cette libre circulation sur le Canal. Deux marchands,
J.-A. Rambaud, à Givors, et J.-B. Richard, du quai Saint-Antoine à
Lyon, se plaignaient des crocheteurs de Givors. Le 29 avril 1791,
ils faisaient la déposition suivante : « Mardi dernier, trois des
domestiques de Rambaud furent troublés dans leur travail,
maltraités,
près de Rive-de-Gier, par les nommés Thivillon fils aîné, Pierre
Seyve et autres, et excédés de coups. Il y a même une plainte à
cet égard au District de la Campagne de Lyon. Le jour d'hier, vers
deux heures, Seyve, Charles Revol, Benoît Pitiot et plusieurs
autres arrêtèrent les manœuvres de Richard et Rambaud, leur
firent laisser ces bateaux vers le territoire des Molières à
Givors où ils sont encore à l’abandon, et menacèrent de tuer
les manœuvres s'ils continuaient à travailler. Toutes ces voies de
fait mettent les plaignants dans la triste perplexité d'être rançonnés
par les cr acheteur s et faire leur commerce avec perte et
désagréments,
de quitter toute espèce de commerce sur le charbon de terre ou d'être
massacrés avec leurs domestiques. »
Une nouvelle ordonnance, interdisant toute
intervention dans la circulation sur le canal, fut publiée le 1er
mai 1791.
|

|
|
Vestige d'une écluse au
bord de l'autoroute A47
|
|

|
UN NOUVEAU PORT.
A l'origine, le port n'avait été que le débarcadère
privé de la propriété foncière où il se trouvait. Dans les
actes notariés du XVIIIe siècle, certaines clauses imposaient aux
fermiers l'obligation d'apporter, au port de Givors, les
approvisionnements à destination de Lyon, capitale régionale et siège
du Chapitre. Le «Péage de Givors » en fit un centre d'échanges
et le siège d'un commerce régional. Mais par suite de
circonstances économiques nouvelles, le commerce du charbon de
terre apporté de Rive de Gier, il va connaître un essor
merveilleux qui transformera l'assiette territoriale de la cité et
fera surgir les fabriques.
La conquête des graviers du Gier va rendre
possible de telles réalisations. Depuis des siècles, entre le
chemin de Rive-de-Gier, sur la rive droite, et celui du Moulin, sur
la rive gauche, les grosses eaux occupaient de vastes espaces,
tandis que pendant les périodes de maigre, des filets d'eau
glissaient entre des graviers, des saulaies, des brotteaux. Ces
terrains incultes formaient une barrière gênante entre la ville
proprement dite et son prolongement récent dans les plaines du
canal, difficilement franchie par des sentiers et des « planches »
en temps normal, par des bateaux lors des crues.
|
|
La Gare d'Eau
|
|
Maîtres de verreries, commerçants, propriétaires riches et influents se proposèrent de mettre en valeur cette plaine aux portes de la ville, dévastée par chaque inondation, de la fertiliser par des travaux d'irrigation, après avoir endigué le Gier et rejeté son cours le plus près possible de la rue du Moulin. Son ancien lit jalonné par Cotéon, la gare de Givors-Ville, la place Pasteur, appelée autrefois place des Petits-Brotteaux, la place Carnot, fut comblé.
Etaient-ils encouragés dans leur effort par les travaux réalisés par l'ingénieur Perrache qui avait conquis les terres amphibies du confluent du Rhône et de la Saône ? Ou étaient-ils au courant des futurs projets de Marc Seguin d'Annonay rêvant de créer une voie ferrée de Saint-Etienne à Lyon? Quoi qu'il en soit, ils constituèrent devant Me Vacheron, notaire à Givors, le 2 juin 1825, la société dite « Société des Graviers du Gier » qui ne sera dissoute qu'en 1868.
Quatre-vingts parts de 1.000 francs furent versées par MM. Bolot (5), Dugas (13), Marcellin (2), Alliment (4), Verzier (1), Lobre (3), Drevet aîné (2) Koch (1), Raspiller (2), Vanginot (2), Dervieux (1), Collet (1), Bignon (4), Laurent (1), Gonnard (1), Revol (4), Viallet (1), Darmency (1), J.-P. Lau- renson (3), Pitrat petit (2), Michel Pitrat (2), Pitrat fils (2), Martinet (1) Barillot (1), Gerin fils (1), Gaillard (1), Gerin (1), Berne (3), Mignot et Cle (1), Mme Barra (1) et Bertholon (1).
|
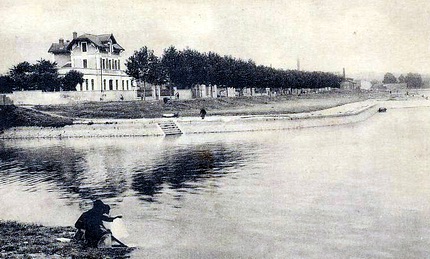
|
|
L'entrée de la Gare d'Eau
et les Quais
|
|
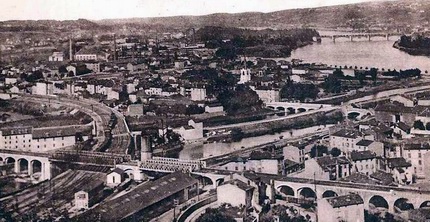
|
Quelques jours après, les associés nommaient président : Bolot, maire ; vice-président : Robichon ; caissier : Dugas ; secrétaire : Me Vacheron. En 44 ans, les sommes versées à chaque possesseur de part se montèrent à plus de 4.500 francs. Le terrain, valant primitivement 1 fr. 50 le m% atteignit le prix de 12 francs en 1854. Ce fut une belle spéculation financière.
Dès 1828, les terrains avaient été acquis et les premiers travaux commencés, lorsque le gouvernement accorda l'autorisation de créer un chemin de fer pour relier Saint-Etienne à Lyon, à la société « Marc Seguin, Biot et CIe ». Givors allait devenir le port charbonnier fluvial non plus de Rive-de-Gier, mais de tout le bassin de la Loire. Pour ne pas perdre de tels avantages, les associés offrirent gratuitement les emplacements nécessaires pour la voie ferrée et pour le « débarcadère » (la gare).
« Le chemin de fer, comme vous le savez, affirmait Dugas, le 21 décembre 1828, doit aboutir au Rhône. C'est une condition de la concession. Mais comment y aboutira-t-il? Comment se feront les
embarquements?
|
|
Chemin de Fer et Gare d'Eau
|
|
« C'est dans cet état qu'une Compagnie de Paris, indépendante du cheminde fer, a conçu le projet de faire creuser une gare dans le milieu de la plaine du Gier, dans laquelle viendraient aboutir et se décharger soit les produits du chemin de fer arrivant de Lyon et de Saint- Etienne, soit les marchandises venant, par le Rhône, du midi et du nord. »
« Elle s'est adressée à nous et a demandé si, attendu que cette gare donnerait indubitablement une grande valeur aux terrains appartenant à notre société, on ne serait pas disposé à faire quelque chose pour sa construction. »
Cette cession de terrains liait pour toujours les intérêts des deux sociétés. Ainsi était né, en 1829, un bassin artificiel qui par son activité sera le grand distributeur de houille pour toute la vallée, plaçant bientôt Givors au premier rang des ports rhodaniens.
Dès 1831, étaient loués des magasins pour l'entrepôt des marchandises Des parcelles de terrains avaient été acquises par le chemin de fer. « Je dois vous dire qu'une société s'est présentée avec le projet de créer, en tête de la plaine, au-dessus du chemin de Montrond, un établissement industriel qui se composerait de plusieurs hauts-fourneaux de fonderie, sablière, ajustage, et de tous leurs accessoires.
|

|
|
Maison éclusière et une
double écluse - Tartaras
|
|

|
MM. Canisius et Cochet qui ont projeté cet établissement ont l'intention d'établir plus tard des fabriques de fer. Pour cela, ils ont traité, avec vos syndics, d'une manière définitive, pour l'acquisition d'environ 21.000 mètres de terrain, en se réservant la faculté, d'ici à quelques mois, d'en prendre à peu près 25.000 de plus. Cet établissement industriel serait le plus avantageux pour les terrains restants dont il augmenterait indubitablement la valeur. »
Le prolongement de la gare d'eau jusqu'au chemin de Montrond était promis à cette nouvelle usine à condition qu'elle « en accepte les frais ».
Poursuivant inlassablement la réalisation de ses desseins, la société des Graviers du Gier avait vendu, de 1829 à 1844, 8 hectares et demi pour 229.094 fr. 45. Dans un apurement des comptes de mars 1832, une vente pour estacades et verreries était évaluée 7.093 fr. 12. C'est l'origine probable du groupe Souchon entre Gier et Gare d'eau.
|
|
Ecluse - Lorette
|
|
L'activité commerciale devint si importante que Camille Dugas, maire de
Givors, et Vincent Mignot, négociant à Annonay, décidèrent, le 12 août 1847» d'augmenter la largeur de la Gare d'eau de 7 mètres du côté
nord, de la prolonger de 200 mètres à l'ouest, d'établir deux voies contiguës de la Freydière à l'ouest du chemin de
Montrond, d'élargir l'entrée de la gare » de manière à faciliter l'accès des bateaux à
vapeur.
Le but que s'étaient proposé les associés en
1829 avait été abandonné et les espaces libres destinés à
l'agriculture recherchés par d'importantes industries. Un nouveau
quartier industriel était né. Tous les travaux entrepris, la
canalisation du Gier dans son nouveau lit bordé de roches,
consolidaient définitivement le côté ouest de la presqu'île de
confluence Gier- Rhône et limitaient très sérieusement les
dangers d'inondation dans ce secteur. Le côté est ne le sera que
beaucoup plus tard par la construction des quais en bordure du
fleuve.
|

|
|
|
L'Hôtel du Canal -
Actuellement l'Hôtel de Ville de Rive de Gier
|
|
|
|
|
|