|
|
HISTOIRE DE LA VILLE
DE RIVE DE GIER -DU CANTON ET DE SES PRINCIPALES INDUSTRIES par C.
CHOMIENNE - 1912
|
|
LA GENESE DU CANAL DE
GIVORS
|
|

|
Depuis longtemps déjà, il avait été question de réunir par un canal
la Loire au Rhône. Un premier projet fut étudié, en 1749, par M. Alléon
de Varcourt, mais il resta lettre morte. En 1760, François Zacharie, de
Lyon, — ingénieur, disent les uns, horloger prétendent les autres,
— fut autorisé par lettres-patentes, à créer à ses frais un canal
auquel il donnait le nom de canal du Forez. Il devait avoir une longueur
de 28.849 toises ; il partait de Givors, passait par Rive-de-Gier,
Saint-Chamond, Saint-Etienne et aboutissait à Bouthéon, sur la Loire.
La concession de la première partie du canal, allant de Givors à
Rive-de-Gier, fut accordée à Zacharie pour une durée de quarante années
en vertu d'un arrêt du Conseil, daté du 28 octobre 1760, et enregistré
par lettres-patentes du 6 septembre 1761. |
|
Rive de Gier - Une écluse
|
|
Le Parlement de Paris, à l'enregistrement des lettres, avait ordonné
que le réservoir projeté au point culminant, à Patroa, serait fait et
établi en même temps que le canal ; cependant, cette première partie
du canal fut seule construite ; elle prit le nom de canal de Givors.
Mais l'entreprenant Lyonnais avait trop présumé de ses forces ; sa
fortune personnelle était complètement engloutie quand le canal,
commencé à Givors, fut parvenu à Saint-Romain-en-Gier.
Les travaux
durent être suspendus ; François Zacharie mourut en 1768.
Toutefois, son fils Guillaume n'abandonna pas le projet paternel. Des
lettres-patentes du 3o septembre 1768 lui transférèrent la concession
et en fixèrent la durée à 60 ans.
En 1774, une Compagnie se constitua
pour continuer l'œuvre ; le capital était de 1.080.000 francs, divisé
en 70 parts de 15.ooo francs chacune, qu'un appel de fonds porta peu après
à 16.000 francs.
Mais découragée bientôt, et ses ressources étant,
devenues insuffisantes, elle menaçait d'abandonner le travail, lorsque
le Gouvernement, sur la demande des actionnaires, doubla les tarifs établis
antérieurement et porta à 99 ans la durée de la concession par
lettres-patentes du 22 août 1779.
|
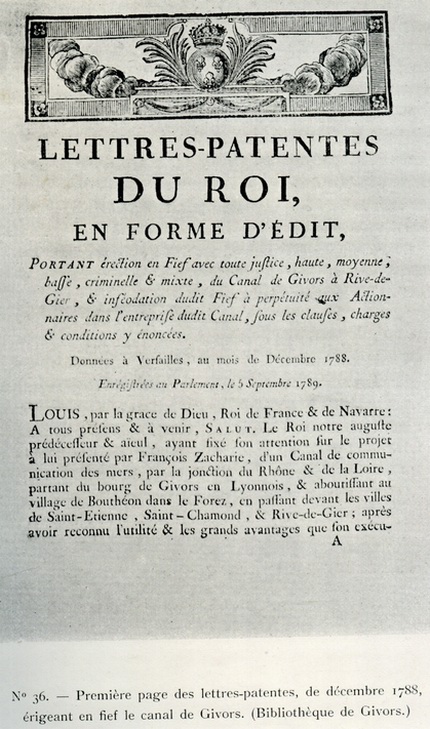
|
|
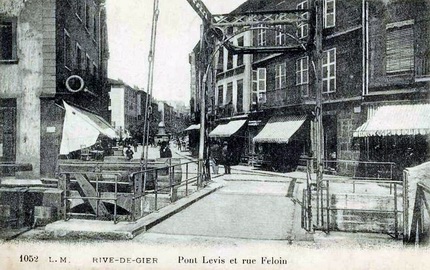
|
Grâce à ces nouveaux avantages, la Compagnie put faire un emprunt et
continuer son entreprise. Enfin, le canal de Givors fut ouvert et livré
à la navigation en 1780, mais il avait été trop rapidement et trop économiquement
tracé ; un certain nombre de biefs perdaient leur eau ; il fallut
reprendre en partie le travail, qui ne fut définitivement achevé que
quelques années plus tard.
À ce moment il avait coûté 3.062.000
livres. Entre ses deux points extrêmes, la pente était de 85 mètres ;
on avait dû aménager 40 écluses,
5 aqueducs et un souterrain taillé dans le roc.
|
|
Rive de Gier - Pont Levis sur le
Canal et rue Feloin
|
|
Le canal avait son point terminus au grand bassin qui fait face à l'hôtel
du canal et il était alimenté seulement par les eaux du Gier, au moyen
de la prise qui existe encore aujourd'hui. Rien tôt on reconnut que les
eaux du Gier étaient insuffisantes pour alimenter le canal pendant
toute l'année, mais en même temps on constatait que la navigation
pourrait être rendue permanente pendant les sécheresses par l'établissement
d'un grand réservoir sur le ruisseau de Couzon, dans lequel serait
recueillie, aux saisons convenables, une quantité d'eau suffisante pour
suppléer à celle de la rivière, lorsqu'elle viendrait à s'épuiser.
L'idée du réservoir de Patroa était définitivement abandonnée. Les
actionnaires du canal s'offraient à exécuter les travaux si le roi, à
titre de dédommagement, leur donnait la propriété incommutable du
canal érigé en fief relevant immédiatement de la couronne, exempt de
tous droits et impositions, avec les autres privilèges et franchises
qu'il était dans l'usage d'accorder aux entreprises publiques.
|
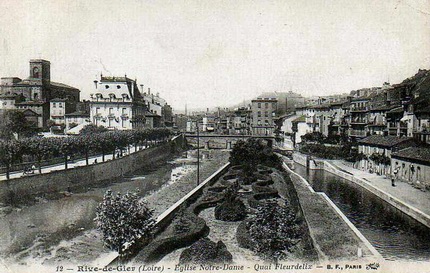
|
|
|
Rive de Gier - Eglise Notre-dame
- Quai Fleurdelix - Le Canal à droite |
|
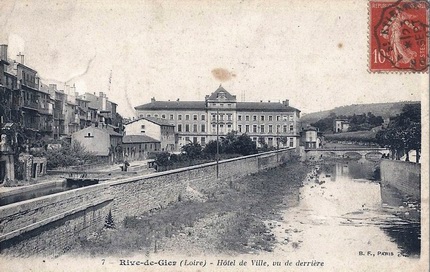
|
Les nouveaux sacrifices devant s'élever à 1.371.551 livres, l'ouvrage
coûterait 4.433.551 livres, sans aucune contribution du Gouvernement.
De nouvelles lettres-patentes du mois de décembre 1788 érigèrent le
canal de Givors à Rive-de-Gier en fief, avec toute justice, haute,
moyenne et basse, criminelle et, mixte, droits de pêche et de chasse
exclusifs. Ses francs-bords, ports sur le Rhône, rigoles et autres dépendances,
ainsi que le magasin de réserve d'eau à construire, avec sa chaussée,
ses rigoles, ses maisons et artifices, relevaient immédiatement de la
Couronne, à titre de fief.
Le roi inféodait aux actionnaires et intéressés, à perpétuité,
ledit fief, fonds et tréfonds, sous la redevance annuelle et perpétuelle
d'un éperon d'or de la valeur de 150 livres tournois qu'ils seraient
tenus de payer, eux et leurs successeurs, le 31 décembre de chaque année,
à compter de 1789 ; et d'un second éperon d'or, tous les vingt ans,
pour tenir lieu des droits de mutation, quints, requints, lods et ventes,
etc. — desquels droits le roi les avait affranchis à perpétuité. |
|
Rive de Gier - Hôtel de Ville,
vu de derrière - Canal de Rive de Gier à Grand croix
|
|
Ajoutons que les propriétaires de ce fief, créé la veille de la Révolution,
avaient la faculté d'établir en tel lieu qu'il leur plairait un juge,
un lieutenant du juge, un procureur de seigneurie et autres officiers
qui connaîtraient en première instance et jugeraient les différends,
au civil, au criminel et mixte, qui naîtraient à raison des dégradations
et délits commis sur les ouvrages, de la perception des droits, des
contestations nées au sujet de la navigation à la charge de l'appel
immédiat de la juridiction ou cour qui en devait connaître.
|
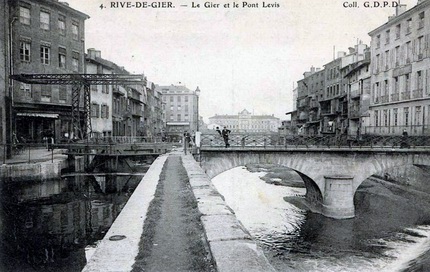
|
|
Rive de Gier - Le Gier et
le Pont Levis |
|
 Page
Précédente Page
Précédente
|

Haut de page |
Page suivante
|
|